Première partie
Les Grecs et les Égyptiens de l'Antiquité l'avaient bien compris : le vin doit être conservé à l'abri de l'air, dans des récipients étanches. Si les premiers connaissaient et utilisaient déjà le bouchon de liège, les autres, en revanche, recouraient surtout à des cires ou à de la poix (substance résineuse) pour obturer leurs amphores. Au Moyen Âge, les vins étaient conservés en barriques. Des bondes en bois enveloppées de toile garantissaient alors une meilleure étanchéité.
L'arrivée, au 17e siècle, de la bouteille en verre a forcé les producteurs à faire preuve d'imagination. Des bouchons de verre sont bien apparus ici et là , mais ils étaient à la fois coûteux et peu pratiques pour l'obturation de la bouteille. Peu à peu, cependant, les bouchons de liège sont devenus la norme pour assurer l'étanchéité et la bonne conservation du vin à l'intérieur de sa cage de verre.
Pour des raisons d'hygiène et d'esthétique, les bouchons sont ensuite lavés à l'eau de Javel ou avec une solution chlorhydrique. Ensuite, on les rince puis on les plonge dans un bain d'acide oxalique afin de neutraliser d'éventuels résidus de chlore. Les bouchons sont rincés une dernière fois à l'eau claire, avant d'être séchés à l'air chaud. Les bouchons défilent sur un tapis roulant pour un premier triage visuel. Ils sont classés d'après leur porosité, leur taille et leur nombre de lenticelles.
Il s'agit d'un travail presque toujours fait à la main. Moins le bouchon renferme de lenticelles, meilleure est sa qualité. Les bouchons avec trop de lenticelles peuvent par contre être améliorés par colmatage. On remplit alors les pores avec un mélange à base de poussière de liège et de colle et on obtient ainsi un bouchon colmaté de belle apparence et de bonne qualité.
D'où vient le liège?
Le liège est un tissu végétal provenant d'un arbre de la famille du chêne. Ce chêne-liège, de son nom latin Quercus suber, se retrouve surtout dans les pays méditerranéens.
Le Portugal et l'Espagne en abritent le plus grand nombre, étant donné leurs conditions climatiques favorables: climat hivernal tempéré et étés secs.
Le chêne-liège, qui peut vivre jusqu'à 200 ans, ne fournit le précieux matériau tiré de son écorce qu'à partir de sa 30e année.
Le liège est recueilli en épluchant l'arbre comme une banane. Par la suite, ces "levées" vont s'effectuer à tous les 9, 12 ou 15 ans.
Enfin, dernières étapes du processus de fabrication, les bouchons sont marqués puis subissent un traitement de surface. Le marquage consiste à estampiller un nom ou un logo sur le bouchon. Le traitement de surface permet de son côté de contourner le problème du coefficient de friction élevé.
En effet, à l'état brut, les bouchons de liège glissent mal, ils sont difficiles à utiliser. Le traitement lubrifie le liège, et facilite la compression du bouchon de même que son introduction dans le goulot de la bouteille. On emploie généralement à cette fin de la paraffine et/ou du silicone. L'inconvénient avec la paraffine, c'est qu'elle s'altère sous l'action de fortes variations de température. Elle peut aussi véhiculer certains micro-organismes, vecteurs de mauvaises odeurs. C'est en partie pourquoi le silicone a fait son apparition comme traitement de surface.
La fabrication du bouchon
On lève l'écorce à la main, en mai et juin. Après avoir pratiqué une entaille horizontale, l'ouvrier introduit la lame de la hache entre l'écorce (liège) et l'arbre pour les séparer délicatement, sans endommager ce dernier. On obtient, au terme de l'opération, une planche de liège.
Le liège n'est pas que lent à se former : il demande également une préparation longue et soignée. Les planches de liège sont d'abord recueillies puis exposées à l'extérieur, aux intempéries, durant une période variant entre un et deux ans. Leur séjour à l'extérieur terminé, les planches sont mises à bouillir pendant 30 à 60 minutes pour éliminer les impuretés et les parasites pouvant se loger dans les lenticelles, les pores du liège. Les planches reposent ensuite dans une pièce chaude, humide et sombre. Au bout de trois semaines, les planches sont triées et classées en fonction de leur épaisseur et leur aspect visuel. Celles trop minces ou avec trop de lenticelles sont rejetées.
Les planches sélectionnées sont ensuite coupées en bandes d'une largeur équivalente à la hauteur du futur bouchon. À l'aide d'un appareil à lames tubulaires opéré de façon manuelle ou mécanique, on découpe les bouchons (le "tirage") dans le sens vertical de la bande de liège. Le sens du tirage est important, car les lenticelles doivent être dans le sens transversal du bouchon et non sur sa longueur, ce qui pourrait créer une dangereuse voie d'accès entre le vin et son environnement extérieur.
À cause des multiples tris au niveau des planches de liège et des retailles générées par le découpage des bouchons, on accumule beaucoup de déchets. Or, on peut réduire ce liège en morceaux et reconstituer la planche ou le bouchon pour fabriquer des bouchons agglomérés. Les granulés obtenus sont triés en différentes catégories – fins, moyens ou gros – selon leur taille et leur densité, à l'aide d'un tamis ventilé.
Les morceaux sont liés entre eux par une colle et moulés selon quatre méthodes: le boudinage, le tubage dans des plaques d'agglomérés, le moulage individuel ou le moulage par centrifugation. Dans le cas du boudinage, le mélange granulés-colle est comprimé dans des tubes à l'aide de pistons. Les boudins sont ensuite coupés à la longueur désirée. Le mélange granulés-colle peut aussi être moulé sous forme de plaque que l'on traite de la même façon que le liège naturel: on coupe en bande, puis on découpe les bouchons. Pour le moulage individuel, chaque moule est rempli avec une quantité de mélange granulés-colle de poids et de volume identiques. Enfin, le moulage par centrifugation, récemment mis au point, n'est privilégié que par certains bouchonniers.
Avant l'expédition, les bouchons sont emballés dans des sacs hermétiques et "stériles", c'est-à -dire contenant très peu de germes. Pour ce faire, on injecte du SO2 dans le sac sous forme gazeuse ou par radiation. Cette dernière méthode nécessite l'utilisation de sacs légèrement perforés, pour permettre une certaine aération.
Source : http://www.vinexpert.com en collaboration avec Christine Leroux, oenologue
Index du forum ‹ Les rubriques ‹ Histoire du vin et de la vigne... découvrir le vin, l'aborder, s'informer ‹ Histoire de vin
12 messages
• Page 1 sur 1
Quatre mots sur le bouchon ...
La vérité est dans la bouteille ..( Lao Tseu )
-

Jean-Pierre NIEUDAN - Messages: 9664
- Inscrit le: Mer 24 Oct 2007 10:23
- Localisation: Hautes Pyrénées
Re: Quatre mots sur le bouchon ...
Deuxième partie
Le roi Liège.
La demande internationale pour les bouchons de liège ne cesse d'augmenter. On retrouve donc sur le marché toutes sortes de qualité à toutes sortes de prix. La technologie ayant beaucoup progressée au cours des 10 dernières années, il est maintenant possible d'évaluer la qualité d'un bouchon à l'aide de valeurs expérimentales mesurables en laboratoire et même dans le chai. Cependant, les meilleures garanties de qualité sont encore l'aspect visuel du bouchon ainsi que l'expérience de l'acheteur. Pourquoi, alors, ne pas privilégier un autre matériau d'obturation? C'est que, malgré la relative rareté de cette ressource naturelle, le liège possède des particularités uniques. Il ne faut pas oublier, non plus, que l'amateur de vin aime bien le côté "poétique" du liège.
Les matériaux de remplacement, outre qu'ils ne sont pas aussi efficaces que le liège, ne conviennent pas aux yeux des amateurs pour les vins d'un certain prestige.
Le liège, une substance inerte, a la particularité de tendre à regagner sa forme originale après avoir été compressé. Cette propriété, appelée le "retour élastique", caractérise le "bon" bouchon et témoigne de son étanchéité. Mais on cherche aussi à obtenir un produit au moindre coût possible. Eh oui, le facteur prix joue là aussi. Dans certains cas, un bouchon d'excellente qualité peut coûter jusqu'à cinq fois plus cher que son homologue bas de gamme.
Différentes sortes de bouchons Les bouchons de liège naturel varient sur le plan qualitatif (7 catégories), mais aussi en ce qui a trait à leurs dimensions.
En règle générale, les longueurs s'établissent à 28, 38, 45, 49 ou 54 mm; pour sa part, le diamètre courant est de 24 mm. Celui-ci peut cependant varier, selon le type de vin : 25 ou 26 mm pour les vins pétillants et 31 mm pour les mousseux comme le champagne. Par ailleurs, plus le vin est destiné à une longue garde, plus son bouchon sera long. La longueur joue cependant très peu sur l'étanchéité, car le goulot s'élargit en descendant. C'est dire que le diamètre minimum de serrage est obtenu dans les 20 premiers millimètres. Le diamètre du bouchon et son élasticité jouent donc un rôle plus important au chapitre de l'étanchéité. On observe des différences de qualité dans les bouchons agglomérés, selon le mode de fabrication, la force et le sens de compression, le type de colle utilisé et la taille des granulés. Plus les granulés d'un bouchon aggloméré sont gros et plus la proportion de colle est faible, plus celui-ci sera élastique. Le liège aggloméré est avantageux par rapport au liège naturel, grâce à sa structure continue sans lenticelles, à sa reproductibilité et au fait qu'il permet le recyclage des retailles. Il permet aussi de produire des lots de bouchons très homogènes
Par nature dense et compact, le bouchon aggloméré peut toutefois être difficile à comprimer lors du bouchonnage et donc ardu à extraire, lors de l'ouverture de la bouteille. Pour compenser cet inconvénient, le diamètre des bouchons agglomérés est donc légèrement inférieur - 23 mm - à celui du bouchon standard de liège naturel. Les bouchons agglomérés sont par contre, de manière générale, disponibles dans les mêmes longueurs que les bouchons naturels. Il est possible de combiner les avantages du bouchon aggloméré avec ceux du bouchon en liège naturel.
En témoigne, le bouchon multi-pièces comme, par exemple, le bouchon de Champagne. Il s'agit, en l'occurrence, d'un bouchon aggloméré dont l'une ou les deux extrémités sont constituées de rondelles de liège naturel. Dans le cas du bouchon de Champagne, le diamètre du bouchon est beaucoup plus gros (31 mm) et la partie en contact avec le vin (à la base) possède deux rondelles de liège naturel.
Les rondelles sont fabriquées de la même façon que les bouchons en liège naturel, sauf qu'elles font 6 à 8 mm d'épaisseur et sont découpées dans le sens de l'épaisseur de la planche, parallèlement aux lenticelles.
La colle utilisée le plus souvent est à base de caséine. On procède de la même façon pour les bouchons destinés aux vins tranquilles, si ce n'est qu'on retrouve une rondelle à chaque extrémité et que le diamètre s'établit à 23 mm - tout comme pour le bouchon 100% aggloméré.
Le "Futura" et le "GDA 1+1" sont de bons exemples de bouchon multi-pièces. On retrouve aussi sur le marché le bouchon monté, constitué d'un morceau de liège fixé sur une rondelle de plastique.
Peu étanche, il sert surtout à boucher les vins fortifiés, les liqueurs et certains alcools. Ces bouchons conviennent donc à des boissons ne s'améliorant pas en bouteille et dont la consommation s'étale sur une longue période de temps.
Au moment de choisir vos bouchons, il est important de vous demander à quel type de vin ils sont destinés : vin de garde, de consommation rapide, appelé à être transporté, etc. Pour le vin assez corsé qui bénéficie d'un séjour prolongé en bouteille, un bouchon de qualité d'une longueur d'au moins 38 mm, est tout indiqué. Par contre, le vin à boire dans l'année s'accommodera sans problème d'un bon bouchon aggloméré. Le bouchon multi-pièces présente quant à lui autant d'avantages sinon plus, que le bouchon de liège naturel. Il pourrait donc remplacer ce dernier dans bien des cas. Malgré le dynamisme du marché, les bouchonniers ont la vie dure, par les temps qui courent.
La pression économique et la concurrence sont telles que les qualités retrouvées sur le marché sont très diversifiées, et à des prix très variés. Un jour sûrement, la technologie nous donnera une matière équivalente au liège. Mais d'ici là , le noble matériau reste notre meilleur choix.
Références :
1. RIBOULET et ALEGOET, Aspects pratiques du bouchonnage des vins, collection Avenir Oenologie, Bourgogne-Publications s.a.r.l., 1986.
2. ROBINSON J., The Oxford Companion to Wine, Oxford University Press, 1994, p.287-288
3. Fédération nationale des syndicats du liège, La Charte des Bouchonniers-Liègeurs, 1989.
Source : http://www.vinexpert.com en collaboration avec Christine Leroux, oenologue
Le roi Liège.
La demande internationale pour les bouchons de liège ne cesse d'augmenter. On retrouve donc sur le marché toutes sortes de qualité à toutes sortes de prix. La technologie ayant beaucoup progressée au cours des 10 dernières années, il est maintenant possible d'évaluer la qualité d'un bouchon à l'aide de valeurs expérimentales mesurables en laboratoire et même dans le chai. Cependant, les meilleures garanties de qualité sont encore l'aspect visuel du bouchon ainsi que l'expérience de l'acheteur. Pourquoi, alors, ne pas privilégier un autre matériau d'obturation? C'est que, malgré la relative rareté de cette ressource naturelle, le liège possède des particularités uniques. Il ne faut pas oublier, non plus, que l'amateur de vin aime bien le côté "poétique" du liège.
Les matériaux de remplacement, outre qu'ils ne sont pas aussi efficaces que le liège, ne conviennent pas aux yeux des amateurs pour les vins d'un certain prestige.
Le liège, une substance inerte, a la particularité de tendre à regagner sa forme originale après avoir été compressé. Cette propriété, appelée le "retour élastique", caractérise le "bon" bouchon et témoigne de son étanchéité. Mais on cherche aussi à obtenir un produit au moindre coût possible. Eh oui, le facteur prix joue là aussi. Dans certains cas, un bouchon d'excellente qualité peut coûter jusqu'à cinq fois plus cher que son homologue bas de gamme.
Différentes sortes de bouchons Les bouchons de liège naturel varient sur le plan qualitatif (7 catégories), mais aussi en ce qui a trait à leurs dimensions.
En règle générale, les longueurs s'établissent à 28, 38, 45, 49 ou 54 mm; pour sa part, le diamètre courant est de 24 mm. Celui-ci peut cependant varier, selon le type de vin : 25 ou 26 mm pour les vins pétillants et 31 mm pour les mousseux comme le champagne. Par ailleurs, plus le vin est destiné à une longue garde, plus son bouchon sera long. La longueur joue cependant très peu sur l'étanchéité, car le goulot s'élargit en descendant. C'est dire que le diamètre minimum de serrage est obtenu dans les 20 premiers millimètres. Le diamètre du bouchon et son élasticité jouent donc un rôle plus important au chapitre de l'étanchéité. On observe des différences de qualité dans les bouchons agglomérés, selon le mode de fabrication, la force et le sens de compression, le type de colle utilisé et la taille des granulés. Plus les granulés d'un bouchon aggloméré sont gros et plus la proportion de colle est faible, plus celui-ci sera élastique. Le liège aggloméré est avantageux par rapport au liège naturel, grâce à sa structure continue sans lenticelles, à sa reproductibilité et au fait qu'il permet le recyclage des retailles. Il permet aussi de produire des lots de bouchons très homogènes
Par nature dense et compact, le bouchon aggloméré peut toutefois être difficile à comprimer lors du bouchonnage et donc ardu à extraire, lors de l'ouverture de la bouteille. Pour compenser cet inconvénient, le diamètre des bouchons agglomérés est donc légèrement inférieur - 23 mm - à celui du bouchon standard de liège naturel. Les bouchons agglomérés sont par contre, de manière générale, disponibles dans les mêmes longueurs que les bouchons naturels. Il est possible de combiner les avantages du bouchon aggloméré avec ceux du bouchon en liège naturel.
En témoigne, le bouchon multi-pièces comme, par exemple, le bouchon de Champagne. Il s'agit, en l'occurrence, d'un bouchon aggloméré dont l'une ou les deux extrémités sont constituées de rondelles de liège naturel. Dans le cas du bouchon de Champagne, le diamètre du bouchon est beaucoup plus gros (31 mm) et la partie en contact avec le vin (à la base) possède deux rondelles de liège naturel.
Les rondelles sont fabriquées de la même façon que les bouchons en liège naturel, sauf qu'elles font 6 à 8 mm d'épaisseur et sont découpées dans le sens de l'épaisseur de la planche, parallèlement aux lenticelles.
La colle utilisée le plus souvent est à base de caséine. On procède de la même façon pour les bouchons destinés aux vins tranquilles, si ce n'est qu'on retrouve une rondelle à chaque extrémité et que le diamètre s'établit à 23 mm - tout comme pour le bouchon 100% aggloméré.
Le "Futura" et le "GDA 1+1" sont de bons exemples de bouchon multi-pièces. On retrouve aussi sur le marché le bouchon monté, constitué d'un morceau de liège fixé sur une rondelle de plastique.
Peu étanche, il sert surtout à boucher les vins fortifiés, les liqueurs et certains alcools. Ces bouchons conviennent donc à des boissons ne s'améliorant pas en bouteille et dont la consommation s'étale sur une longue période de temps.
Au moment de choisir vos bouchons, il est important de vous demander à quel type de vin ils sont destinés : vin de garde, de consommation rapide, appelé à être transporté, etc. Pour le vin assez corsé qui bénéficie d'un séjour prolongé en bouteille, un bouchon de qualité d'une longueur d'au moins 38 mm, est tout indiqué. Par contre, le vin à boire dans l'année s'accommodera sans problème d'un bon bouchon aggloméré. Le bouchon multi-pièces présente quant à lui autant d'avantages sinon plus, que le bouchon de liège naturel. Il pourrait donc remplacer ce dernier dans bien des cas. Malgré le dynamisme du marché, les bouchonniers ont la vie dure, par les temps qui courent.
La pression économique et la concurrence sont telles que les qualités retrouvées sur le marché sont très diversifiées, et à des prix très variés. Un jour sûrement, la technologie nous donnera une matière équivalente au liège. Mais d'ici là , le noble matériau reste notre meilleur choix.
Références :
1. RIBOULET et ALEGOET, Aspects pratiques du bouchonnage des vins, collection Avenir Oenologie, Bourgogne-Publications s.a.r.l., 1986.
2. ROBINSON J., The Oxford Companion to Wine, Oxford University Press, 1994, p.287-288
3. Fédération nationale des syndicats du liège, La Charte des Bouchonniers-Liègeurs, 1989.
Source : http://www.vinexpert.com en collaboration avec Christine Leroux, oenologue
La vérité est dans la bouteille ..( Lao Tseu )
-

Jean-Pierre NIEUDAN - Messages: 9664
- Inscrit le: Mer 24 Oct 2007 10:23
- Localisation: Hautes Pyrénées
Re: Quatre mots sur le bouchon ...
Merci à Jpierre pour cette intéressante contribution.
Il suffit que je la lise, et pan ! Une bouteille bouchonnée dans l'heure qui suit (un Morgon 2006 de chez Piron)...
La dernière en date remontait à cet hiver (Sociando-Mallet 2001 ).
).
Mes impressions personnelles me disent que je dois être bien en dessous des 10%, malgré une seuil de perception assez bas, enfin je crois...
Cuisinant trop rarement au vin, les bouteilles défecteuses finissent comme sur la photo d'Alain, bien que tout le monde me dise : "mets le avec le gigot".
Ce qui m'inquiète, c'est d'imaginer que ce goût puisse ce constituer au sein d'un environnement particulier : notre cave. Sans être parano : "et si du TCA se formait dans ma cave sans que je soit au courant" ? Il n'y à pas de charpente à traiter, certes, mais peut-être existe t'il d'autres conditions favorable à son développement ? Quelqu'un a t'il quelques connaissances sur le sujet ?
PS : Une autre rubrique à alimenter avec la sempiternelle question du remplacement du liège ; c'est un autre débat.
Amicalement
Cyrille.
Il suffit que je la lise, et pan ! Une bouteille bouchonnée dans l'heure qui suit (un Morgon 2006 de chez Piron)...
La dernière en date remontait à cet hiver (Sociando-Mallet 2001
Mes impressions personnelles me disent que je dois être bien en dessous des 10%, malgré une seuil de perception assez bas, enfin je crois...
Cuisinant trop rarement au vin, les bouteilles défecteuses finissent comme sur la photo d'Alain, bien que tout le monde me dise : "mets le avec le gigot".
Ce qui m'inquiète, c'est d'imaginer que ce goût puisse ce constituer au sein d'un environnement particulier : notre cave. Sans être parano : "et si du TCA se formait dans ma cave sans que je soit au courant" ? Il n'y à pas de charpente à traiter, certes, mais peut-être existe t'il d'autres conditions favorable à son développement ? Quelqu'un a t'il quelques connaissances sur le sujet ?
PS : Une autre rubrique à alimenter avec la sempiternelle question du remplacement du liège ; c'est un autre débat.
Amicalement
Cyrille.
-
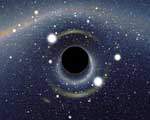
Torschutz - Messages: 275
- Inscrit le: Lun 21 Jan 2008 13:19
Re: Quatre mots sur le bouchon ...
Etes-vous sensible au "goût de bouchon" du vin lorsqu'il a servi en cuisine?
Nous n'avons pas tous la même perception sensorielle. Mon épouse a beaucoup de peine à détecter le goût de bouchon. Souvent elle trouvera le vin bizarre ou pas bon.
J'ai déjà employé des bt légèrement bouchonnées pour des sauces. On ne le sentait plus. Par contre je n'ai jamais tenté l'expérience avec des vins fortement bouchonnés.
Christian
Christian Rausis
-

Christian Rausis - Messages: 3732
- Inscrit le: Sam 8 Déc 2007 14:04
- Localisation: Valais
Re: Quatre mots sur le bouchon ...
Bouchage : Château Margaux conduit des expériences avec capsule à vis
http://www.vitisphere.com/breve.php?id_breve=54276
Christian
http://www.vitisphere.com/breve.php?id_breve=54276
Christian
Christian Rausis
-

Christian Rausis - Messages: 3732
- Inscrit le: Sam 8 Déc 2007 14:04
- Localisation: Valais
Re: Quatre mots sur le bouchon ...
J'ai lu quelque part que des essais étaient en cours en Suisse également depuis assez longtemps, le problème était que justement les vins ne vieillissaient pas... Ce qui n'est pas le but recherché! Malheureusement je ne trouve plus ce dit article... 
Sébastien
«Redoutez les effets du vin, mais observez pourtant qu'il y a beaucoup plus de vieux ivrognes que de vieux médecins.»
(Sacha Guitry)
«Redoutez les effets du vin, mais observez pourtant qu'il y a beaucoup plus de vieux ivrognes que de vieux médecins.»
(Sacha Guitry)
- SébastienF
- Messages: 124
- Inscrit le: Ven 26 Oct 2007 11:57
- Localisation: Les Paccots - Suisse
Re: Quatre mots sur le bouchon ...
Personnellement j'aime bien ce système http://www.gualaseal.com/, c'est joli et ça m'a l'air plus technique que la capsule à vis, de plus ça laisse passer l'air! J'ai quelques bouteilles en cave fermées de cette manière et franchement pas de soucis avec, de plus le côté"traditionnel" est respecté! Elles proviennent du domaine Capitain-Gagnerot à Ladoix-Serrigny en côte de Beaune. Il parait que d'autres domaines bourguignon s'y sont mis.
http://www.capitain-gagnerot.com/
http://www.tgvins.com/fr/Les_vins/nouve ... tique.html
Pas mal d'autres infos sur Google
http://www.capitain-gagnerot.com/
http://www.tgvins.com/fr/Les_vins/nouve ... tique.html
Pas mal d'autres infos sur Google
Sébastien
«Redoutez les effets du vin, mais observez pourtant qu'il y a beaucoup plus de vieux ivrognes que de vieux médecins.»
(Sacha Guitry)
«Redoutez les effets du vin, mais observez pourtant qu'il y a beaucoup plus de vieux ivrognes que de vieux médecins.»
(Sacha Guitry)
- SébastienF
- Messages: 124
- Inscrit le: Ven 26 Oct 2007 11:57
- Localisation: Les Paccots - Suisse
Re: Quatre mots sur le bouchon ...
L'idée de mettre ce suppositoire dans ma bouteille me gène un peu...
Le jour où nous aurons la preuve que tout ce plastoc ne relargue ni plastifiants, ni polymères en présence prolongé avec le l'alcool à 13%, laors je changerai peut-être d'avis...
Le jour où nous aurons la preuve que tout ce plastoc ne relargue ni plastifiants, ni polymères en présence prolongé avec le l'alcool à 13%, laors je changerai peut-être d'avis...
BAREME DE NOTATION 19+ À 20:MYTHIQUE 18+ À 19:EXCEPTIONNEL 17+ À 18:TRÈS GRAND VIN 16+ À 17:GRAND VIN 15+ À 16:TRÈS BON VIN 13+ À 15:BON VIN 11+À 13:MOYEN 10 À 11:FAIBLE <10:DÉFECTUEUX
en dessous de 16, je n'achète pas! il y a si bon ailleurs!
en dessous de 16, je n'achète pas! il y a si bon ailleurs!
- Vincent R.
- Messages: 8877
- Inscrit le: Ven 26 Oct 2007 08:32
- Localisation: Entre Béarn et Bigorre
Re: Quatre mots sur le bouchon ...
Rassures-toi, il est déjà mis!!  Après c'est une question de goût, si tu as une capsule c'est aussi du plastique qui est en contact avec le vin!
Après c'est une question de goût, si tu as une capsule c'est aussi du plastique qui est en contact avec le vin!  Perso ça me gène moins ce type de bouchon, j'aurais du mal à acheter un Château Margaux avec une...capsule
Perso ça me gène moins ce type de bouchon, j'aurais du mal à acheter un Château Margaux avec une...capsule 
Sébastien
«Redoutez les effets du vin, mais observez pourtant qu'il y a beaucoup plus de vieux ivrognes que de vieux médecins.»
(Sacha Guitry)
«Redoutez les effets du vin, mais observez pourtant qu'il y a beaucoup plus de vieux ivrognes que de vieux médecins.»
(Sacha Guitry)
- SébastienF
- Messages: 124
- Inscrit le: Ven 26 Oct 2007 11:57
- Localisation: Les Paccots - Suisse
Re: Quatre mots sur le bouchon ...
Sebastien,
Il est mis dans les tiennes
La capsule n'a qu'un film de silicone en surface alors que le bouchon fait quelques centimètre-cubes de plastique. Le silicone, on a du recul, les alliages de polymères, un peu moins et les plastifiants, on commence à en voir les effets...
Quand tu ouvres une bouteille chère (limite hors de prix) et que n'a pas de facture et quelle s'avère bouchonnée, tu regrettes la capsule à vis...
Il est mis dans les tiennes
La capsule n'a qu'un film de silicone en surface alors que le bouchon fait quelques centimètre-cubes de plastique. Le silicone, on a du recul, les alliages de polymères, un peu moins et les plastifiants, on commence à en voir les effets...
Quand tu ouvres une bouteille chère (limite hors de prix) et que n'a pas de facture et quelle s'avère bouchonnée, tu regrettes la capsule à vis...
BAREME DE NOTATION 19+ À 20:MYTHIQUE 18+ À 19:EXCEPTIONNEL 17+ À 18:TRÈS GRAND VIN 16+ À 17:GRAND VIN 15+ À 16:TRÈS BON VIN 13+ À 15:BON VIN 11+À 13:MOYEN 10 À 11:FAIBLE <10:DÉFECTUEUX
en dessous de 16, je n'achète pas! il y a si bon ailleurs!
en dessous de 16, je n'achète pas! il y a si bon ailleurs!
- Vincent R.
- Messages: 8877
- Inscrit le: Ven 26 Oct 2007 08:32
- Localisation: Entre Béarn et Bigorre
Re: Quatre mots sur le bouchon ...
Je ne suis pas chimiste, mais d'après ce que j'ai lu sur ces bouchons ils utilisent des matériaux adaptés à l'agroalimentaire et même à la chirurgie cardiovasculaire, ce qui me semble t'il limite les risques de contamination. A voir sur la durée....
Sébastien
«Redoutez les effets du vin, mais observez pourtant qu'il y a beaucoup plus de vieux ivrognes que de vieux médecins.»
(Sacha Guitry)
«Redoutez les effets du vin, mais observez pourtant qu'il y a beaucoup plus de vieux ivrognes que de vieux médecins.»
(Sacha Guitry)
- SébastienF
- Messages: 124
- Inscrit le: Ven 26 Oct 2007 11:57
- Localisation: Les Paccots - Suisse
Re: Quatre mots sur le bouchon ...
Je suis chimiste mais n'en sais guère plus que toi 
maintenant si tu savais ce que l'on trouve dans l'agro-alimentaire, tu cesserais définitivement de manger
Il faut relativiser quand on connait la durée de vie d'une prothèse ou d'un implant.
J'espère garder mes meilleures bouteilles plus longtemps (certaines devraient me survivre )
)
maintenant si tu savais ce que l'on trouve dans l'agro-alimentaire, tu cesserais définitivement de manger
Il faut relativiser quand on connait la durée de vie d'une prothèse ou d'un implant.
J'espère garder mes meilleures bouteilles plus longtemps (certaines devraient me survivre
BAREME DE NOTATION 19+ À 20:MYTHIQUE 18+ À 19:EXCEPTIONNEL 17+ À 18:TRÈS GRAND VIN 16+ À 17:GRAND VIN 15+ À 16:TRÈS BON VIN 13+ À 15:BON VIN 11+À 13:MOYEN 10 À 11:FAIBLE <10:DÉFECTUEUX
en dessous de 16, je n'achète pas! il y a si bon ailleurs!
en dessous de 16, je n'achète pas! il y a si bon ailleurs!
- Vincent R.
- Messages: 8877
- Inscrit le: Ven 26 Oct 2007 08:32
- Localisation: Entre Béarn et Bigorre
12 messages
• Page 1 sur 1
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 3 invités